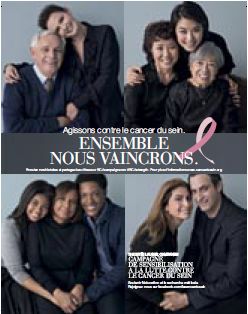Les tests génomiques peuvent orienter vers une désescalade thérapeutique. Pour mieux connaître leurs bénéfices, un observatoire en vie réelle a été lancé. Entretien avec le Pr Elsa Curtit, oncologue médicale au CHU de Besançon et à l’Institut régional fédératif du Cancer de Franche-Comté.
Qu’est-ce qu’un test génomique ?
Les cancers du sein qui expriment les récepteurs hormonaux (RH+) et sans surexpression de HER2 (HER2 –) représentent environ 70 % des cancers du sein. Dans ce sous-type le plus fréquent, on retrouve une maladie hétérogène en termes de pronostic et de réponse aux traitements. Les traitements indiqués chez les patientes et patients atteints de ce type de cancer sont la chirurgie, la radiothérapie et l’hormonothérapie, auxquelles peuvent s’ajouter une chimiothérapie adjuvante en fonction du risque estimé de rechute et de la sensibilité de la maladie à ce traitement. Ce niveau de risque est difficile à estimer sur les critères cliniques et anatomopathologiques habituels. Les tests génomiques permettent d’analyser directement l’ARN tumoral pour évaluer l’agressivité de la tumeur. Cette information permet de décider ou non du bénéfice à recevoir une chimiothérapie. Il existe quatre tests, dont deux ont fait l’objet d’études prospectives, et un seul, Oncotype DX®, est considéré comme fiable avec un très haut niveau de preuve selon les recommandations de l’association américaine d’oncologie, signées par le Pr Fabrice André de Gustave-Roussy.
Quel impact les informations fournies par les tests génomiques ont-elles sur le plan clinique ?
Cela a eu un impact considérable. En 2000, aux Etats-Unis, la chimiothérapie était systématiquement proposée en cas de tumeur de plus de 1 cm. Depuis l’arrivée des tests, on considère que le recours à la chimiothérapie dans cette indication a diminué de 50 % à deux tiers. Cette désescalade est plus importante chez les patientes ménopausées. Chez les patientes non ménopausées, le score de risque doit être très bas pour éviter la chimiothérapie.
Quelles sont les conséquences pour les personnes concernées ?
Généralement, en France, la chimiothérapie repose sur 6 cycles de trois semaines. Il s’agit de chimiothérapie aux effets indésirables lourds à court terme (alopécie, fatigue, arrêts de travail, dégradation de la vie professionnelle, familiale et sociale, etc.) et à long terme (augmentation du risque cardiovasculaire, dégradation de la fertilité, etc.). Si le retour à une vie « normale » est favorisée par l’activité physique adaptée, cela peut prendre des mois voire plusieurs années. Les bénéfices médico-économiques directs et indirects ont également été prouvés.
Comment ces tests sont-ils accessibles en France ?
Contrairement aux Etats-Unis, en Europe et en France, les indications d’accès aux tests génomiques sont restreintes selon des critères peu lisibles. Quant au remboursement total, il est acté dans différents pays d’Europe (Pays-Bas, Irlande, Espagne, Suède, République tchèque, Hongrie, Suisse, Espagne Italie et Grèce). En Angleterre, en Ecosse, en Belgique, en Norvège, en Pologne et en Allemagne, les tests sont remboursés en cas d’atteinte ganglionnaire chez les patientes ménopausées. La France, quant à elle, pratique un remboursement partiel dans l’enveloppe RIHN ; environ 1 000 euros restent à la charge des établissements de soins.
Comment l’impact en vie réelle destests génomiques est-il évalué ?
Jusqu’ici, nous n’avions pas de données, mais nous travaillons sur une étude hors loi Jardé de recueil de données de soins, l’étude FREDO ODX. Le CHU de Besançon est le promoteur de cette étude, qui compte actuellement 17 centres investigateurs pour cet observatoire du test Oncotype DX®. L’objectif est de recenser 4 500 patientes et patients traités en France dans des centres qui utilisent Oncotype DX®
et ensuite de pouvoir étudier leur profil, les délais de prise en charge et d’accès au test et la prise en compte du résultat de la signature génomique dans la stratégie thérapeutique. Ces données serviront aux praticiens, mais aussi à l’Agence nationale de sécurité du médicament qui aura des données supplémentaires pour évaluer ces tests.
Gézabelle Hauray
Photo : © Julia Smolnik-Design ohne Titel / DR
Article extrait du dossier Grand Angle spécial Cancer du Sein réalisé par CommEdition, parution dans Le Monde daté du 4 octobre 2025