
Les cancers gynécologiques représentent un fardeau pour le quotidien de milliers de patientes diagnostiquées chaque année. Mais, grâce à l’innovation thérapeutique, de nouveaux espoirs se concrétisent depuis quelques années.
Moins connus que les cancers du sein ou du col de l’utérus, certains cancers affectant les femmes sont pourtant un sujet de mobilisation majeure pour les oncologues, en raison de leur prévalence. C’est le cas pour les cancers de l’ovaire et de l’endomètre, qui touchent respectivement environ 6 000 et 8 500 femmes par an (2023), quand les nouveaux cas de cancers du col de l’utérus ne concernent qu’environ 3 000 nouvelles patientes par an. Les cancers gynécologiques pelviens désignent un ensemble de pathologies cancéreuses qui s’attaquent à l’appareil reproducteur féminin. « Ala différence des cancers du sein et du col de l’utérus, très présents dans les médias, les cancers pelviens restent peu identifiés par le public, indique Amel Zoubir, directrice médicale Oncologie de GSK France. Il est donc important de sensibiliser les femmes : ces cancers sont d’autant mieux soignés qu’ils sont diagnostiqués tôt. »
Analyser le profil de la tumeur
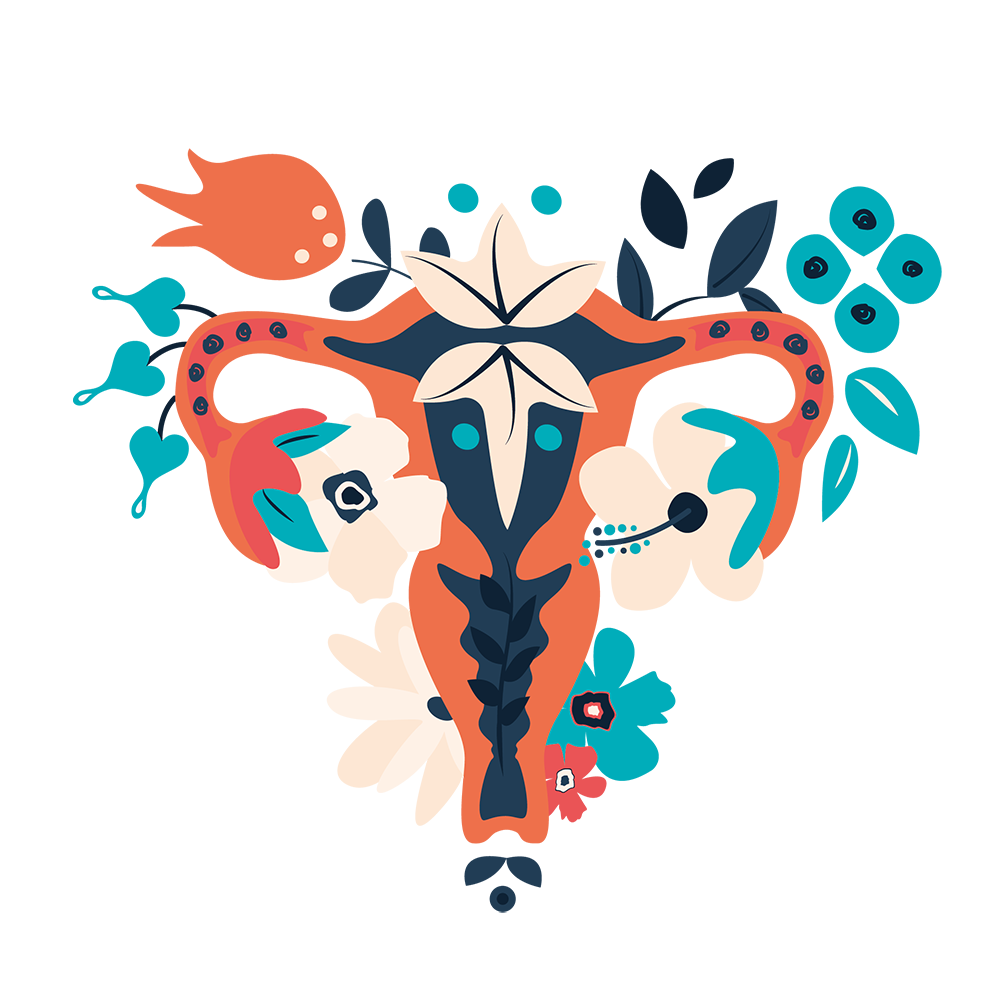
GSK fait partie des entreprises les plus engagées dans le soutien à la cause des femmes atteintes de cancers pelviens. « En tant qu’entreprise de santé, nous sommes d’abord impliqués dans la mise à disposition de traitements innovants, susceptibles d’améliorer le pronostic pour certaines patientes, précise Amel Zoubir. Les solutions thérapeutiques que nous développons visent à garantir une médecine personnalisée, basée sur la recherche du type histologique et moléculaire de la tumeur, afin de pouvoir adapter la stratégie thérapeutique au profil de la patiente. Nous proposerons prochainement une immunothérapie indiquée contre certaines formes agressives du cancer de l’endomètre. » L’endomètre est la muqueuse qui tapisse la paroi intérieure de l’utérus. à chaque cycle menstruel, il s’épaissit et se vascularise pour pouvoir accueillir un embryon. Si l’ovule n’est pas fécondé, l’endomètre se desquame constituant les règles. « Le cancer de l’endomètre se déclare en moyenne vers l’âge de 68-69 ans, dans les trois quarts des cas chez des femmes ménopausées, ajoute Amel Zoubir. Les cancers de l’endomètre sont associés à plusieurs facteurs de risque : âge, obésité, diabète de type 2, exposition prolongée aux œstrogènes. Dans de rares cas l’origine peut être une prédisposition génétique : des mutations, notamment dans le syndrome de Lynch, qui augmentent le risque.
Attention aux saignements
Si les symptômes et signes d’alerte ne sont pas spécifiques, ils sont importants à connaître pour consulter à temps un médecin. Les saignements vaginaux anormaux chez les femmes ménopausées, ou en dehors des périodes de règles, constituent un premier signe d’alerte pour se rendre chez le gynécologue. D’autres manifestations peuvent également alerter comme des pertes vaginales (leucorrhées), douleurs pelviennes, douleurs pendant les rapports (dyspareunie), difficultés ou douleurs lors de la miction et, plus rarement, présence d’une masse palpable. La pose du diagnostic associe un examen clinique, une échographie endovaginale qui mesure l’épaisseur de l’endomètre, une biopsie de l’endomètre réalisée par aspiration ou curetage, qui permet de diagnostiquer la plupart des cancers, et une surveillance spécifique (chez les patientes présentant un syndrome de Lynch, une échographie et une biopsie annuelle sont recommandées à partir de 35 ans).
L’immunothérapie entre en scène

Pour les cancers de bon pronostic, notamment lorsqu’ils sont diagnostiqués de façon précoce, le traitement de première intention combine le plus souvent chirurgie et radiothérapie, voire de l’hormonothérapie. Et pour les formes les plus agressives, l’immunothérapie devient une solution de première ligne. « Notre innovation permet de prendre en charge près de 20 % des patientes atteintes de cancer de l’endomètre avancé métastatique. En France environ 2 000 patientes ont pu en bénéficier a travers le programme d’accès précoce, illustre Amel Zoubir. Il s’agit le plus souvent de patientes nouvellement diagnostiquées ou en situation de récidive métastatique. »
Informer et soutenir
Aux côtés des soignants et des associations de patients, GSK s’engage pleinement pour mieux informer le grand public sur les cancers gynécologiques pelviens et accompagner les malades durant leur parcours de soins. L’entreprise soutient par exemple l’événement Septembre Turquoise, le mois de sensibilisation aux cancers gynécologiques pelviens. Elle a également co-conçu, avec l’association IMAGYN, l’initiative Cocon : une caravane qui, depuis cinq ans, sillonne la France à la rencontre des patientes atteintes de cancers de l’ovaire et de l’endomètre. « C’est une opération qui nous tient particulièrement à cœur, témoigne Amel Zoubir. à chaque édition, on peut constater la nécessité impérieuse, pour les patientes et leurs proches, de pouvoir être écoutés, de partager leur vécu et de s’informer sur des sujets souvent tabous, comme la prise en charge de la douleur, le lien psycho-social ou la vie sexuelle. »
Pierre Mongis
Cancers pelviens : pas de géant dans les traitements
Professeur en oncologie médicale et praticienne au Centre François-Baclesse à Caen, le Pr Florence Joly fait part des progrès dans la prise en charge des deux principaux cancers féminins gynécologiques pelviens, ceux de l’endomètre et de l’ovaire.

Vous êtes spécialisée dans la prise en charge des cancers gynéco-logiques pelviens, notamment ceux de l’ovaire et de l’endomètre. Quelles sont les caractéristiques de ces pathologies ?
Ce sont les deux types de cancers gynécologiques pelviens les plus fréquents, en particulier le cancer de l’endomètre, qui touche environ 8 500 femmes par an. C’est le 1er cancer gynécologique pelvien et le 4e cancer chez la femme, toutes formes confondues. Le cancer de l’ovaire, pour sa part, avec près de 5 000 nouveaux cas par an, est un peu moins répandu, et fait partie des formes rares de cancer. C’est le 9e cancer féminin en termes de fréquence. Le cancer de l’endomètre est en progression régulière, en raison de l’évolution des modes de vie dans les pays développés. C’est malheureusement une maladie de « société », dont la prévalence est étroitement liée à celles du diabète et de l’obésité. Le cancer de l’endomètre est d’ailleurs une préoccupation majeure de santé publique aux états-Unis, en raison du nombre croissant de femmes avec une obésité majeure. En revanche, l’incidence du cancer de l’ovaire est plutôt stable.
Que sait-on des causes de ces cancers ?
L’avancée en âge représente le premier facteur de risque pour ces pathologies, avec un âge moyen de 68 à 69 ans pour l’endomètre et aux alentours de 65 ans pour l’ovaire. Dans le cas du cancer de l’endomètre, outre les co-morbidités que je viens d’évoquer (diabète, hypertension, obésité…), des causes génétiques sont associées dans 3 à 5 % des cas, en particulier pour les femmes atteintes du syndrome de Lynch. Une prise prolongée d’un traitement hormonal de la ménopause (THM ou THS) pourrait également accroître ce risque. La nulliparité, une puberté précoce (avant 8 ans) ou une ménopause tardive (après 55 ans) constituent des facteurs de risque du cancer de l’ovaire. Sur le plan environnemental, l’obésité est impliquée, mais de manière bien moindre que pour le cancer de l’endomètre. Et il faut évoquer également le cas particulier des femmes atteintes d’une altération ou d’une mutation des gènes BRCA, qui les expose à ce qu’on appelle le « syndrome seins-ovaire » (15 à 20% des cas). Enfin, le nombre d’ovulations tout au long de la vie augmente le risque de cancer de l’ovaire, avec une plus forte exposition chez les femmes n’ayant pas eu d’enfants.
Quels sont les signes d’alerte à connaître et comment est traité un cancer de l’endomètre ?
Les métrorragies, c’est-à-dire des saignements intervenant chez des femmes ménopausées ou en dehors des périodes de règles, sont le premier motif d’alerte. Ce symptôme permet le plus souvent le diagnostic de la maladie à un stade « précoce » ou « localisé » qui, traitée, sera de bon pronostic. Une fois le diagnostic posé, la chirurgie, qui comprend l’ablation de l’utérus, des trompes et des ovaires, constitue l’intervention de référence. Les techniques ont beaucoup progressé avec notamment le robot chirurgical et des techniques modernes de repérage des ganglions permettant d’éviter de lourdes chirurgies sans curage ganglionnaire. La radiothérapie est parfois nécessaire après la chirurgie en fonction des caractéristiques moléculaires de la tumeur. Cependant, dans 25 % des cas, il est nécessaire d’initier un traitement par médicament, en raison d’un stade avancé de la maladie. Ce traitement comprend de la chimiothérapie et plus ou moins de l’immunothérapie. Parmi ces patientes avec une maladie avancée, 20 % auront un cancer avec une anomalie de la réparation de l’ADN dénommée dMMR/MSI (anomalie constante dans le syndrome de Lynch), ce qui rend la tumeur particulièrement sensible à l’immunothérapie. Les résultats chez ces patientes sont spectaculaires avec, en moyenne, un doublement de l’espérance de vie et des phases de rémission considérablement rallongées. S’il est trop tôt pour affirmer que ces patientes sont guéries, les travaux se poursuivent pour progresser dans le contrôle de la maladie et pour avancer dans la voie d’une médecine de précision, adaptée aux caractéristiques de chaque tumeur et au profil de chaque patiente : la médecine personnalisée.
Et pour le cancer de l’ovaire ?
Malheureusement, le cancer de l’ovaire reste de pronostic défavorable, car il est le plus souvent détecté à un stade avancé en l’absence de symptômes spécifiques. Le biomarqueur CA 125 est fréquemment élevé, mais insuffisamment spécifique pour un dépistage systématique, tout comme l’échographie abdominale. L’usage futur de l’IA, capable d’intégrer de nombreux paramètres, pourrait favoriser un diagnostic plus précoce. La prise en charge est complexe et repose sur des équipes pluridisciplinaires. Le traitement vise à opérer pour retirer toutes les lésions, souvent après une chimiothérapie initiale destinée à réduire la tumeur. Celle-ci est ensuite poursuivie quelques mois pour renforcer le contrôle de la maladie. Un traitement d’entretien est souvent proposé, notamment pour les patientes porteuses d’anomalies des gènes BRCA, avec une nouvelles classe thérapeutique qui cible ces anomalies, « les inhibiteurs de PARP », thérapies ciblées qui ont significativement amélioré leur survie. Le risque de rechute reste cependant élevé, nécessitant une nouvelle chimiothérapie, voire une nouvelle chirurgie si celle-ci est possible.
Notre portefeuille de traitements s’enrichit grâce aux avancées technologiques et thérapeutiques qui permettent de coupler la chimiothérapie avec un anticorps qui va se fixer sur une cible présente sur la cellule cancéreuse, avec une meilleure diffusion du traitement dans la cellule, comme par exemple un anticorps conjugué qui cible les récepteurs aux folates. Grâce aux avancées de la recherche clinique, notamment au sein du groupe Gineco, la France bénéficie d’un accès rapide à l’innovation, ouvrant l’espoir d’allonger l’espérance de vie des patientes en récidive.
Propos recueillis par Pierre Mongis
Photo © GSK France / DR – Illustrations © shutterstock.com- GSK / DR
Article extrait du dossier Grand Angle spécial Cancer réalisé par CommEdition, parution dans Le Monde daté du 18 octobre 2025.












