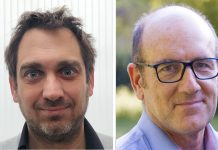La lutte contre le diabète passe par une meilleure compréhension des mécanismes de la maladie. Une approche destinée à personnaliser les traitements selon les profils des patients, comme l’explique le Pr Pierre Gourdy, endocrinologue et PU-PH au CHU de Toulouse.
La prévalence du diabète de type 2 ne cesse d’augmenter. Comment l’expliquer ?
En effet, en dépit de la mobilisation des autorités sanitaires, partout dans le monde, le diabète continue de progresser, sans que nous parvenions à maîtriser l’épidémie. La prévalence croissante de la maladie est particulièrement préoccupante dans les pays en voie de développement, où les populations accèdent rapidement aux modes de consommation des pays riches. Mais sa progression reste également soutenue dans les pays développés. Pour le diabète de type 2, les causes principales sont connues. Les déséquilibres nutritionnels, associés à la sédentarité, restent les premiers vecteurs de l’épidémie. Mais la recherche scientifique a également révélé l’importance des facteurs génétiques et épigénétiques favorisant la transmission transgénérationnelle du risque de diabète. Ainsi, de la conception à la vie in utero, l’exposition aux troubles métaboliques des parents augmente le risque de leurs enfants d’être eux-mêmes atteints de diabète au cours de leur vie. Par ailleurs, il faut rappeler l’importance des facteurs socio-économiques. Les personnes défavorisées, moins accessibles aux actions de prévention, sont davantage exposées au diabète de type 2.
Le diabète de type 1 est également en progression. Quelles en sont les causes ?
En 2021, des données diffusées par Santé publique France ont en effet montré une prévalence en hausse de ce diabète chez les enfants et les adolescents. S’il reste difficile d’en établir les causes précises, il est probable que des modifications de l’environnement jouent un rôle majeur dans la progression de ce diabète. Plusieurs travaux soutiennent par exemple l’hypothèse d’un lien entre certaines affections virales et le déclenchement du diabète de type 1 chez des personnes génétiquement prédisposées. Dans tous les cas, il est impératif de mieux comprendre l’histoire naturelle des diabètes de type 1 et type 2, mais également de mieux identifier les formes plus rares de la maladie, en particulier celles liées à des anomalies génétiques.
Justement, que peut nous apporter la science pour améliorer la prévention et le traitement du diabète ?
La science nous aide à développer une connaissance plus fine des différents types de diabète dans le but d’améliorer les actions de prévention et de dépistage, mais aussi d’élaborer des stratégies thérapeutiques plus personnalisées. Parmi les pistes explorées par des équipes françaises, je citerai les démarches en cours pour favoriser le dépistage précoce du diabète de type 1, optimiser l’identification des diabètes d’origine monogénique ou établir des scores de prédisposition polygénique au diabète de type 2. D’autres approches visent à mieux caractériser le risque de développer des complications du diabète de type 2, en particulier sur le plan cardiovasculaire et rénal, en analysant le profil inflammatoire de certaines cellules sanguines. L’ambition de ces efforts de recherche est de nous donner les moyens, dans un avenir proche, d’individualiser nos stratégies de prise en charge préventive ou thérapeutique pour une efficacité optimale et une approche médico-économique raisonnée, selon les principes de la médecine de précision.
Les classes thérapeutiques les plus récentes constituent une avancée dans la prise en charge du DT2. En quoi changent-elles la donne pour les patients ?
Au cours de la dernière décennie et jusqu’à ces derniers mois, plusieurs grandes études ont clairement démontré l’intérêt majeur des dernières classes arrivées sur le marché, les inhibiteurs du SGLT2 et les analogues du GLP-1 (aGLP-1). Au-delà de leurs actions bénéfiques sur le contrôle de la glycémie et sur la réduction du poids, ils permettent en effet de réduire la survenue ou la progression des complications cardiovasculaires et rénales du diabète de type 2. Les recommandations nationales et internationales préconisent désormais leur utilisation systématique en cas d’atteinte avérée ou chez les patients présentant un risque élevé de développer ce type de complications. Pour les personnes atteintes de diabète de type 2, ces médicaments constituent déjà une avancée majeure, en permettant une prise en charge holistique du diabète et de ses principales complications, et en favorisant l’observance grâce à la simplification des modes d’administration.
Antoine Largier
Information communiquée en collaboration avec Novo Nordisk – FR25CORP00048
Photo : © Insulet / DR
Article extrait du dossier Grand Angle spécial Diabète réalisé par CommEdition, parution dans Le Monde daté du 15 novembre 2025.